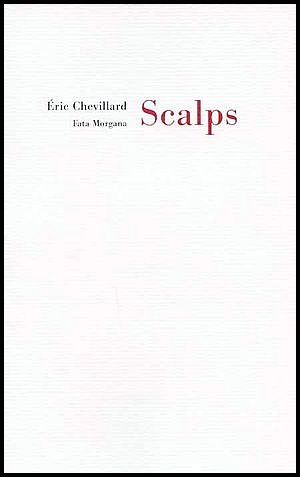Le recueil de nouvelles Scalps d’Éric Chevillard est une lecture que je vous conseille. Mes textes préférés sont « Les taupes », « Œuvre » et « Le lapin ».
Chevillard manie l’ironie avec talent et nous emporte dans ses courts récits avec un regard critique sur la société.
La nouvelle « Les taupes » existe sous différentes formes sur Internet. Mais jamais dans le respect de sa version originale… on la trouve même bardée de fautes d’orthographe et (mal) modifiée. Je vous invite donc à découvrir ici le véritable texte extrait du recueil Scalps :
Les taupes
Quand il était enfant, la propriété de ses parents jouxtait celle de Samuel Beckett, à Ussy. Rien ne l’amusait tant que de lancer des taupes par-dessus le mur, dans le jardin de l’écrivain. A l’en croire, cela constituait même sa principale distraction. Peut-être son unique distraction même. Aujourd’hui, il tire fierté de cet ancien voisinage et, de ses jeux d’enfant, il se vante. On n’entend que lui.
Quand j’étais enfant, nous habitions à côté de chez Samuel Beckett, à Ussy. Je m’amusais à lancer des taupes dans son jardin.
On n’a aucune peine à le croire. C’est un homme au regard biais qui raconte cela, et ses dents sont vilaines. Il est professeur d’électrotechnique au lycée Désiré Nisard. Ça lui plaît. Il prétend avoir un bon contact avec les élèves. Mais on remarque surtout la maladie de sa peau, ces plaques rouges sur son visage et sur ses mains, la desquamation, les croûtes.
Eczéma chronique. Une forme compliquée, rare. Je mets des pommades.
Nous ne lui avons rien demandé. Beckett, ça nous intéresse d’avantage. Cet homme a tout de même vécu dans le voisinage de Beckett. Quels souvenirs a-t-il gardés de lui ?
Je lançais des taupes dans son jardin quand j’étais petit.
Donc voici un homme qui a tout de même vécu plusieurs années dans le voisinage de Beckett et qui n’a rien de mieux à nous raconter que cela. Il lançait des taupes dans son jardin, par-dessus le mur, pour s’amuser.
J’enfumais leurs galeries. Elles sortaient de terre, hébétées, zigzagantes, éblouies. Que c’est con, une taupe au soleil. Je les assommais avec le plat d’une pelle sans les tuer.
Puis il les lançait par-dessus le mur, chez Beckett, nous savons cela. En somme, ce gamin idiot cherchait noise à l’un des grands génies de son siècle. Or il ne semble toujours pas en éprouver la honte aujourd’hui. C’est peut-être cela le plus étonnant. Car il bombardait de taupes le jardin de Beckett, à l’en croire. Et les taupes dévastaient le jardin de Beckett. Et Beckett en était certainement affligé.
Nous sommes en présence de quelqu’un qui délibérément a causé du tort à Beckett et qui s’en vante encore aujourd’hui. Il nous raconte cela parce qu’il sait que nous aimons la littérature et Beckett. Voudrait-il nous impressionner avec son histoire ? Susciter notre jalousie, ou notre admiration peut-être. Comme un qui se vanterait d’avoir nourri avec Beckett une relation privilégiée.
J’ai bien connu Beckett. J’ai même lancé des taupes dans son jardin.
Il est le seul à pouvoir en dire autant. Qui d’autre ? Personne. Ni les plus proches de Beckett n’ont eu avec lui ce rapport-là.
Seulement moi.
Ou bien dirige-t-il maintenant contre nous la malveillance dont il fit preuve envers Beckett ? Voudrait-il nous atteindre, nous, aujourd’hui, avec ces mêmes taupes qui déjà ont atteint Beckett ? Sachant que nous aimons la littérature et Beckett, espère-il nous blesser en nous racontant cela ? Dirige-il sournoisement contre nous à présent son canon à taupes ?
Et il est vrai que nous souffrons bien un peu en imaginant le vol des taupes lancées comme des grenades par-dessus le mur de Beckett. Nous souffrons de les voir tomber sur la pelouse de Beckett, dans les plates-bandes de Beckett, et aussitôt creuser leur trou. Et voici dévasté le jardin de verdure où Beckett trouvait enfin la paix. Voici la ruine dans le jardin de Beckett, là où était la paix. Le chaos a repris ses droits sur ce terrain. On lui a prêté main-forte. Le globe terrestre est tout retourné dans le jardin de Beckett. Voyez, on dirait un champ de bataille lamentable. L’herbe n’y pousse plus. Le globe terrestre est plein de bosses dans le jardin de Beckett. Et l’autre là, le sale gamin, ce crétin qui s’en amuse encore. Et son sourire découvre ses dents toutes vilaines à l’exception de trois ou quatre qui manquent.
J’attrapais les taupes étourdies par la peau du cou, et hop ! je les lançais de l’autre côté du mur, dans le jardin de Samuel Beckett, l’écrivain.
Peut-être aussi n’a-t-il point du tout l’intention de nous blesser. Fait-il seulement étalage de sa bêtise. Comme il en a ! Jamais vu tant d’un seul tenant.
D’un côté du mur, Beckett, dans les douleurs de son œuvre acharnée, considérable. De l’autre côté du mur, le sale gamin chassant les taupes, décidé à lui nuire. Et qui aujourd’hui encore s’en vante.
C’était de petites taupes brunes, presque noires, au poil lisse, aux mains et aux pattes roses, très menues. Qui valsaient de l’autre côté du mur comme des grenades. Qui vite s’enfouissaient dans les plates-bandes de Beckett, sous sa pelouse, et faisaient bien du dégât. Parfois pointaient une tête minuscule, affolée, au sommet de l’une ou l’autre taupinière, comme Winnie dans Oh les beaux jours.
C’était le bon temps, en effet. J’étais un enfant joueur, espiègle, assez taquin. Un vrai diable, disait ma mère.
Un vrai sale gosse. Tête à claques. Et le cul pour la botte. Aujourd’hui encore. On éloignerait volontiers de sa main la pommade qui apaise ses démangeaisons. On balancerait bien le tube de l’autre côté de son mur.
Il vécut dans le voisinage de Beckett et ne trouva rien de mieux à faire que de lancer des taupes dans son jardin. Au lieu de lui apporter des mûres, des champignons, des noix. Au lieu de courir au bureau de tabac acheter ses cigarettes. Il capturait des taupes pour les jeter dans son jardin. Au lieu d’être son petit page, son écuyer. Au lieu de ramasser les feuilles mortes sur sa pelouse. Au lieu de laver sa voiture.
Je capturais les taupes et je les lançais dans son jardin, par-dessus le mur.
Il nous raconte cela aujourd’hui comme son plus haut fait d’armes. Il ne serait pas plus fier s’il avait mordu Gandhi. De temps en temps, tout en parlant, il détache avec un ongle, de sa joue ou de son front, une écaille de peau morte.
Beckett écrivait à quelques pas de chez lui les plus fortes pages de la littérature de ce temps. C’était du travail, et de la souffrance. Ça ne venait pas tout seul. L’angoisse ne laisse rien passer. Il faut lui arracher chaque mot. Beckett écrit, penché sur sa table. Parfois il relève la tête. Par la fenêtre, il voit voler une taupe. Puis une deuxième, qui atterrit lourdement comme la première dans les plates-bandes. Ou plutôt non. Beckett est absorbé depuis plusieurs heures dans son travail. Dehors, le jour décline. Beckett relève la tête pour contempler sa pelouse qui devient bleue au crépuscule. C’est une vision qui l’apaise chaque soir, après écrire. Mais s’étend devant lui à perte de vue un terrain dévasté, des tertres funéraires, tous les morts du jour ont été enterrés dans son jardin.
J’ai bien connu Samuel Beckett. Il a même pu m’arriver de lancer dans son jardin jusqu’à douze taupes d’affilée.
Au lieu de se mettre à son service. De veiller sur le silence alentour. De gratter la terre de ses chaussures après les longues promenades. De polir son bâton de marche.
Vous voyez Beckett, le beau visage de Beckett taillé dans l’os, abrupt, sans prise pour les expressions vicieuses ou vulgaires, trop moites et qui décrochent. Vous voyez la haute silhouette altière de Beckett, la pointe aiguë de son œil éternellement jeune. Vous connaissez ses livres. Il y a maintenant ce type-là qui nous raconte comment il s’employa durant toute son enfance à lui empoisonner l’existence.
J’enfumais les taupinières. Dès que les taupes effarées sortaient de terre, je les capturais. Tantôt je les assommais sans les tuer avec le plat d’une pelle, tantôt je les attrapais avec l’épuisette de mon père. Puis je les lançais d’une main sûre dans le jardin de Beckett, par-dessus le mur mitoyen.
Il y avait Beckett pris au piège des pensées et cherchant. Et de l’autre côté du mur, ce gamin idiot. Beckett cherchant au moins à connaître le piège des pensées et pourquoi cette mâchoire nous happe. Et cette recherche la menant sans trêve ni repos, et non sans succès parfois. Et ce succès ne le gardant pas pour lui alors – ne gardant que la plaie, la brûlure, offrant le remède et la vengeance. Puis relevant la tête et par la fenêtre découvrant le jardin dévasté. Les taupes ont tout démoli avec leurs petites mains roses. Quelle tristesse ! Les volcans sont plus soigneux de leurs environs.
C’était moi ! C’était moi leur bras armé. C’était moi qui lançais toutes ces taupes par-dessus le mur qui séparait notre jardin de celui de Beckett.
Il s’en vante. Aujourd’hui encore, il en est tout épanoui. Puis décolle avec l’ongle une croûte noire sur sa tempe. Son regard détaille avec insistance le corps de ses collègues féminines du lycée Désiré Nisard. Sa langue est d’un rose trop pâle, passe et repasse mollement sur ses lèvres sèches, fendillées. Il laisse pousser ses ongles, il en fait l’usage que l’on sait – quand bien même aurions-nous préféré l’ignorer toujours. Il a connu Samuel Beckett. Il a pesé un peu sur son destin.
Si Beckett a saisi sa pelle et sa bêche pour réparer les dégâts causés par les taupes, c’est bien grâce à lui. Nous dirons plus justement par sa faute. Plusieurs fois par sa faute Beckett a dû interrompre son travail. Il a repoussé devant lui la page où se précisaient les moyens de sortir honorablement du piège des pensées et comment le détruire ou plutôt le faire jouer pour nous, en notre faveur enfin. Beckett est sorti dans son jardin. Tristement, il a erré entre les taupinières. Peut-être a-t-il vu une taupe tomber du ciel encore, dans l’herbe, qu’il n’a pas tuée. De l’autre côté du mur, le garçon des voisins poussait des cris stridents.
C’était moi !
Qui d’autre ? Toujours aussi bête aujourd’hui, et mauvais, et content de lui. On se renseigne discrètement pour savoir où il habite. On le suit. On conçoit des projets de vengeance.
Nous aurions aimé vivre dans le voisinage de Beckett. Nous aurions pris garde de respirer trop fort. Plutôt mourir que tousser. Nos cerisiers auraient lancé leurs plus belles branches par-dessus le mur mitoyen. C’est d’avantage ce type de rapports que nous aurions privilégiés avec Beckett. Il n’eût point été question de taupes dans nos rapports avec Beckett. Nous nous serions installés là, à côté de chez Beckett, pour être les voisins silencieux dont les écrivains rêvent. Il aurait pu nous croire absents.
Moi je vous parle de taupes, mais je faisais aussi beaucoup de bruit. Et puis je ne lançais pas que des taupes dans le jardin de Beckett, mais aussi des limaces, des crapauds, des pommes de pin, des pierres. Tout était projectile. Tout passait par-dessus le mur. Un chat crevé, une fois. Il avait fallu le trouver.
Ainsi il parle, il parle, et détache du bout de l’ongle ses croûtes, ses peaux mortes. Que la lèpre emporte le reste !
Éric Chevillard, in Scalps, Ed. Fata Morgana, 2004.
 Beckett at Ussy – Photo de 1953. Collection Lawrence Harvey.
Beckett at Ussy – Photo de 1953. Collection Lawrence Harvey.
Samuel Beckett (à gauche) et son frère Frank
Pour en savoir + :
– Voyez les Douze questions à Éric Chevillard
– Visitez L’autofictif, le blog d’Éric Chevillard